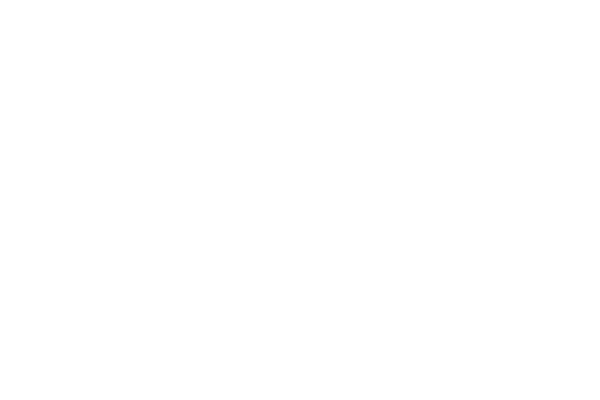AVERTISSEMENT : Ceci
n’est qu’un avis que vous n’êtes en aucune manière obligé de partager.
Mon humble but ici est de proposer une lecture de mon ressenti. Si
d’aventure vous vous sentez l’âme d’un justicier en déposant une pêche
dans la section des commentaires, sachez que cela ne me fera pas changer
d’avis et que vous perdrez votre temps. En vous remerciant pour votre
compréhension…
Cet imposant pavé de plus de 500 pages nous est présenté dans un bel écrin par les éditions de M. Toussaint Louverture [1]. Nous suivons les aventures de Karen Reyes – avatar fantasmé de l’auteur – qui enquête sur le meurtre de sa voisine de palier, une certaine Anka Silverberg… Reyes apparaît comme l’une de ces adolescentes complexées, fascinée par les monstres, elle s’imagine souvent en privé « dur à cuire » à la dégaine de lycanthrope.
Cet imposant pavé de plus de 500 pages nous est présenté dans un bel écrin par les éditions de M. Toussaint Louverture [1]. Nous suivons les aventures de Karen Reyes – avatar fantasmé de l’auteur – qui enquête sur le meurtre de sa voisine de palier, une certaine Anka Silverberg… Reyes apparaît comme l’une de ces adolescentes complexées, fascinée par les monstres, elle s’imagine souvent en privé « dur à cuire » à la dégaine de lycanthrope.
Le dessin au bic, vendu comme une des originalités de l’ouvrage alors que la technique a déjà été exploitée plusieurs fois [2], n’est pas dénué de cachet. Les couvertures de faux magazines de cinoche horrifique type « Fantagoria » qui séparent les chapitres sont d’une facture tout à fait appréciable et convoquent une contre-culture à laquelle je ne peux qu’être sensible. C’est d’ailleurs la partie la plus appréciable de la BD. La patte d’animatrice et de publicitaire de l’auteure transparaît dans la composition des planches, dans l’attention accordée à une homogénéité symétrique qui frappe l’œil dès la première vision.
Si le graphisme est à la hauteur, où est le problème ? Simple ! Emil Ferris ne sait pas réaliser une bande dessinée. La lourdeur pachydermique de son découpage chaotique m’a assommé. En conséquence, la lecture de cette œuvre s’est étirée sur des semaines et des semaines du fait de longues pauses. Revenir à ces pages pachydermiques a nécessité de prendre une inspiration profonde pour essayer de décortiquer ces arabesques nonsensiques comme un Champollion fou.
La narration écrite se perd dans des circonvolutions abracadabrantesques, fait des nœuds dans sa propre histoire, abuse d’une pénible glossolalie rhétorique qui surligne chaque minuscule détail superfétatoire. On pourrait mes rétorquer à raison que c’est un effet de style littéraire, mais ici cela ne fonctionne pas et procure non l’immersion mais une prégnante migraine après dix minutes de lecture. L’ensemble aurait dû subir une relecture attentive : entre les répétitions, les adverbes et les phrases alambiquées placées de manière gratuite au petit bonheur la chance, c’est un festival d’horreur pour les yeux.
Je ne pense pas que les traducteurs soient pour quelque chose dans ce massacre. Ce style, je le reproche à l’auteure ! Et si le conditionnement de l’édition française est un écrin à la limite de la flagornerie, je ne subodore pas que ses responsables aient eu un quelconque mot à dire sur le produit d’origine. Mes piques s’adressent surtout à la publication américaine, aux personnes qui auraient pu convaincre Ferris de tailler dans le vif d’un script abscons.
N’en déplaise aux nombreux laudateurs, une BD transmet ses informations nécessaires à la suspension consentie de l’incrédulité et à la maturation des émotions par le prisme de l’image ; or ici, on est loin du compte : la mise en page sous forme de cahier, qui part d’une bonne idée pour coller au thème de l'adolescence, nuit à la clarté de l'ensemble ; les dessins correspondent avec une remarquable exactitude aux interminables descriptions embrouillées que l’on a lues quelques minutes plus tôt ; le découpage saute d’une séquence à l’autre sans rime, ni raison, se permet des torsions pour flatter l’œil, mais perd en route sa logique événementielle… N’est pas Fred qui veut, etc.… En résumé, l’auteure sacrifie le confort de son auditoire sur l’autel d’une esthétique snobinarde assez insupportable.
Puisque l’ouvrage se place dans la catégorie très discutable des « romans graphiques », je reviens un petit moment sur sa narration : si nous emboitons le pas à une adolescente, alors le style ampoulé de l'auteure n’épouse jamais les perceptions de son personnage. On sent le poids de l’adulte qui essaie – sans jamais y parvenir – de retrouver ses sensations de jeunesse. Sans parler de singer l'écriture d’une gamine dans l’Amérique en plein bouleversement des années 60, ce qui est une vraie gageure[3] en soi, il est tout de même possible de créer l'illusion d'une voix intérieure, en usant d'une prose en décalage constant avec les situations rencontrées...[4] Les outils stylistiques existent, encore faut-il avoir l’imagination pour les utiliser. Je ne m'étendrais même pas sur l'apparition des appétences charnelles qu’explore ce pénible monologue et qui n’échappe pas au psychologisme de comptoir. Cette complaisance laudative a poussé de quelques crans supplémentaires ma détestation de cette BD. C’est une appréciation subjective, mais ce sujet n’apporte à mon sens pas grand-chose à l’histoire et il est exposé de manière si prosaïque, avec si peu de subtilité, que cela en devient embarrassant.
Conséquence de tout cela, le propos initial se délite dans un bric-à-brac incompréhensible. En dépit du marasme ambiant, certaines séquences fonctionnent. J’ai tout de même goûté le passage sur le traitement des prostituées dans l’Allemagne Nazie, qui est raccord avec la symbolique du monstre créé par Ferris, bien que cette séquence soit amenée dans le récit avec la finesse d’un bulldozer aviné [5].
Mais plus encore que ce qui aurait dû rester un modeste récit à la première personne, un de ces exercices égotiques sans plus d’incidence que nous inflige depuis quelques décennies déjà le milieu de la BD dite « underground », s’est retrouvé par la grâce d’un air du temps délétère propulsé au rang de chef-d’œuvre insurpassable.
C’est non sans ce que je nomme, de manière péremptoire, une certaine fierté que les rabats du quatrième de couverture nous apprennent qu'Emil Ferris a contracté le virus du Nil lors d’un voyage en Égypte. Conséquence immédiate, notre auteure a dû réapprendre à dessiner, et c’est de cette résurrection miraculeuse qu’est né ce fœtus de BD.
Qu’on soit bien d’accord, cela est fort dommageable pour elle, mais cela ne contribuera pas à me rendre plus sympathique cet ouvrage qui m’est apparu comme, au mieux, antipathique. Qu’on se le tienne pour dit : on a tous nos problèmes et être malade, handicapé ou même tétraplégique n’est pas ce qui nous dote du talent ultime ! Comme l’époque nous oblige à souligner l’évidence : quels que soient votre condition physique et votre sexe, vous n’excellerez dans votre domaine de prédilection qu’avec une pratique journalière, assidue et une remise en question de tous les instants. Être affecté d'un quelconque particularisme n’est pas et ne sera jamais un sésame pour produire une œuvre de qualité. Je ne dis pas qu’Emil Ferris n’a pas sué sur ce livre, en revanche je maintiendrai qu’avant de passer le stade la publication, le manuscrit aurait dû bénéficier d’un travail éditorial musclé pour éviter des scories et gagner en efficacité tout en perdant des pages superflues dans l’opération.
Je demande à un auteur de m'entraîner à la découverte, à travers une narration qui respecte les règles de l’art, une vision, une interprétation du monde, une rêverie, quelque chose qui me montre le meilleur de l’humanité, étant donné que nous sommes quotidiennement confrontés à la médiocrité de notre apathique époque. Que la santé de madame Ferris soit défaillante est une donnée biographique qui peut éclairer certaines choses si d'aventure la passion qu'elle nous inspire nous pousse à disséquer ses œuvres, à essayer de comprendre le pourquoi du comment de la formation de ses thèmes de prédilections, mais ce n’en est en aucun cas un argument valable pour adopter une posture de supériorité qualitative. Et cela ne nous dispense pas, en tant que lecteurs avisés et matures, de débrancher notre esprit critique !
Comme je m’attaque à un ouvrage qui bénéficie d’une impressionnante aura de légitimité dans le minuscule milieu éditorial, je vais tenter de tirer ici une conclusion de tout cela. Il y a une myriade de points problématiques à soulever sur ce livre, mais d’une part cela aurait étiré au-delà du raisonnable ce texte déjà bien trop long, d’autre part cela aurait nécessité des recherches documentaires que je n’ai hélas, ni le temps, ni les moyens et surtout pas l’envie de mener. Donc :
J’appuierai ici sur un point que me reprocheront sûrement les idiots de notre merveilleuse époque : je n’ai rien contre les femmes dans les arts. Que du contraire même !
Cependant, les travaux qu’elles fournissent doivent être à la hauteur de mes attentes. Dans le cas qui nous occupe, j’ai plus l’impression que cet album a été produit pour satisfaire à des desiderata sociétaux plutôt que qualitatifs, ce qui a sur moi un effet émétique foudroyant !
D'autant que ce type d’œuvres masquent mal une idéologie, qui tend de plus en plus vers la propagande se généralise. Particulièrement dans le monde de la BD francophone et américaine qui me paraît plus perméable aux discours simplistes faisant une part belle aux raisonnements tronqués et autre sophisme. L’ironie dans le cas d’Emil Ferris c’est que celle-ci traite du nazisme en usant d’une symbolique pompière qui maquille à la truelle son sermon implicite et explicite.
Mais peut-être que je me trompe, que je sur interprète. Peut-être… Il n’en demeure pas moins qu’au final toute cette littérature est survendue à l'excès, car, au risque de me répéter, ce n’est pas vos orientations sexuelles, vos maladies ou vos handicapes qui font votre talent. C’est un travail constant et opiniâtre, quelles qu’en soient les conséquences sur soi et sur les autres qui sont la marque des artistes digne de ce nom… À l’inverse de l’imagerie d’Épinal, pratiquer ce sacerdoce n’est pas enviable et le prix à payer en est souvent élevé que ce soit dans ses relations sociales, amoureuses ou laborieuses. Cela n’a rien de glamour. C’est une répétition ennuyeuse de gestes pour réussir à arracher à la vase une création qui ait un minuscule intérêt.
Ce qui me fout en rogne c’est de placer sur un piédestal la personne derrière le crayon plutôt que le résultat sur la planche. En l'état Emil Ferris m’a infligé un pensum assommant. Et si je comprends l'idée qui sous-tend ses scènes, la matérialisation sur le papier échoue sur tous les tableaux à être lisible.
Mais des femmes qui écrivent et qui dessinent avec un peu plus de talent et de faconde, il y en a ! Et il y en aura toujours. Et c'est tant mieux ! Tellement en fait que je ne pourrais pas avoir assez de deux vies pour parcourir les œuvres qu’elles nous ont donnés. Néanmoins, je ne m’adonnerais pas à cette ivresse sur le simple fait qu’elle ait une vulve comme appareil reproducteur, mais bien parce qu’elles ont eu un cerveau et une imagination d'une puissance infinie qui a embrassé tous les paradoxes de la créature humaine.
D’ailleurs pour certaines d’entre elles qui rentrent dans mon panthéon personnel des auteurs qui m’ont le plus marqué et je serais incapable de de pratiquer la dissection critique sur leurs travaux de peur d’y égarer ma plume dans un océan de richesses. Plus tôt que de perdre votre temps précieux dans la lecture de ces monstres navrants, abîmez-vous dans les mondes d’Ursula K. Le Guin, allez à la rencontre de la féline Omaha auquel Kate Worley a prêté sa voix, goûtez aux vaudevilles survoltés de Rumiko Takahashi, à la science-fiction douce amère de Moto Hagio, explorez les origines de la littérature gothique avec Mary Shelley ou avec les sœurs Brönte, creusez les profondeurs de l’horreur avec Shirley Jackson ou Tanith Lee, frissonnez avec le western cannibale d’Antonia Bird : Vorace… et tant d’autres.
Quand on cherche, on trouve !
____________________________________________________
[1] — lesquels ont réédité le plus fréquentable Watership Down de Richard Adams, que je vous recommande plutôt…
[2] — notamment par Cromwell, l’auteur d’Anita Bomba dont je vous conseillerai plutôt la fréquentation. D’autant que les éditions Akileos ont sorti une bien belle intégrale.
[3] — Un petit tacle gratuit à Oscar & la Dame Rose d’Eric Emmanuel Schmidt qui est un cas d’école de non-écriture dans le genre, avec ses phrases simple à la naïveté mécanique qu’on croirait jaillir d’une IA qui simulerait l’écriture d’un enfant.
[4] — L’auteur de SF Jack Womack dans le glaçant Journal de nuit dont la réalité cauchemardesque est à nos portes parvient à simuler le style d’une adolescente de douze ans de manière crédible, avec toutes ses contradictions.
[5] — Bien que le même sujet a été traité d’une manière beaucoup plus réussie et assez poignante dans la 27e lettre de Will.