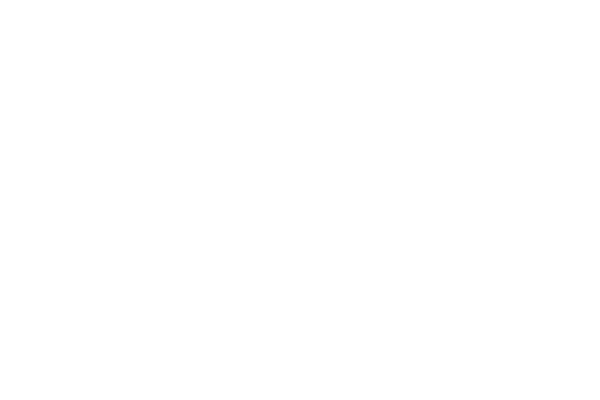Apparu en marge du Festival Fantastique de Bruxelles, l’Offscreen dépoussière des pelloches rares et/ou peu connues du grand public. Une occasion donc pour s’abreuver à une autre source que celle des distributeurs classiques des multiplexes et de déguster des cinémas différents, de nous secouer dans nos habitudes audiovisuelles. La programmation – touffus comprenant autant des nouveautés que moult rétrospectives – ne m’a pas permis d’assister à toutes les projections, néanmoins j’ai pu découvrir quelques perles…
1. Grave de Julia Ducornau (2017).
L’œuvre d'ouverture de ce festival et en même temps la bête à hype du moment est-elle la hauteur de sa flatteuse réputation ? Pour ma part, je n’ai pas accroché à ce timide délire cannibale, la réalisatrice se refusant toute exagération propre à ce style de cinéma. Si la première demi-heure bien sociétale sur les bizutages en école supérieure de médecine annonce une ambiance anxiogène à base de rituels stupides, le reste demeure convenu, voire assez chiant.
Comme c’est trop souvent le cas quand les français s’essaient au cinéma « de genre », la cinéaste se contemple en train filmer. C’est appliqué, parfois réussi, mais en général assez plat. La faute peut-être à un parti-pris graphique très faible – on est loin des décadrages, des focales déformantes, de l’emploi ingénieux du hors-champs et autres astuces qui font parties de la panoplie du réalisateur d’horreur – ce qui donne une consistance atonale à l’ensemble. Oui, c’est trash et vulgaire, mais cela ne suffit pas à transcender son sujet qui n’est qu’effleuré.
La réalisatrice préfère perdre son temps à nous dépeindre les beuveries estudiantines dans toutes leurs décadences, échouant systématiquement à les utiliser pour nourrir son propos. Tous les acteurs mâchent leurs mots – une désagréable manie des dialogues « réaliste » qui plombe le cinéma « d’auteur » français – tant et si bien que je n’ai compris certains échanges qu’en lisant les sous-titres néerlandais. Le scénario ne décolle que vers la fin et la toute dernière image aurait pu servir d’incident déclencheur et nous emmener dans un autre film, plus perturbant.
Une œuvre auteurisante, dans le mauvais du terme, qui a de plus à une fâcheuse tendance au fétichisme gratuit. Une projection dispensable, et ce n’est pas parce que c’est estampillé « de genre » et « réaliser par une femme » que cela en fait une merveille. En ce qui me concerne, dans un registre similaire, le Vorace d’Antonia Bird n’a pas encore trouvé d’équivalent dans l’excellence.
2. La Belle et la Bête de Juraj Herz (1978).
La rétrospective conte de fée tchèque m’aura permis de redécouvrir des adaptations de classiques pour le moins surprenantes, stylisées, souvent faites de bric et de broc, mais suffisamment audacieuses pour que l’absence de budget soit palliée par une inventivité de tous les instants. Cette version de la Belle et la Bête est une bonne entrée en matière, introduite par un préambule du réalisateur lui-même. Le recours à la fantasy n’a rien d’étonnant dans le contexte politique communiste de la Tchéquie de l’époque, la censure idéologique demeurant assez forte. Pourtant, les quelques échantillons de ce cinéma présentés à l’occasion de ce festival ont conservé une puissance d’évocation peu commune.
Si le genre horrifique n’était pas permis, Juraj Herz se sera servi des contes pour laisser libre cours à ses envies de fantastiques et d’épouvante, conférant une aura maléfique au récit de Madame Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Oubliez donc la mièvre Bête de l’oncle Walt, car la première demi-heure décrit un monstre impitoyable. Dans une forêt toujours enveloppée de brume, la « Bête » — d’abord filmé comme un tueur en série de slasher, souffle et caméra subjective incluse — fond sur une caravane de marchands en un enchaînement d'attaques mortelles. La créature, un mélange d’homme et d’oiseau de proie, ne plaisante pas et ceux qui entrent dans son territoire le paient au prix de leurs vies.
Mais la Bête ne serait pas grand-chose sans un décor à sa démesure. Le château déliquescent qui renvoie à une noblesse en fin de règne, évoque plus la Maison de Usher et E.A. Poe que les fanfreluches que l’on appose volontiers à ce conte romantique. Peuplée d’anciennes statues inquiétantes, de serviteurs mutiques constitués de suie et de marécages méphitiques, la demeure de la Bête n’eût certes pas déplu au Dracula de la Hammer. D’autant que le réalisateur joue dès qu'il le peut avec les zones d’ombre et le hors champ (coucou Grave…) pour instaurer une atmosphère de cauchemar. Idée originale : la déformation en Bête, en partie inexpliquée, semble provenir d’une malédiction ancestrale se transmettant de génération en génération ainsi que le suggère une série de portraits.
Si l’histoire d’amour demeure convenue, fleuretant avec le ridicule le plus achevé, c’est qu’elle n’intéresse pas Juraj Herz que l’on sent plus impliquée dans la création d’une ambiance ténébreuse et dont les nombreux effets de style saisissant n’ont rien à envier aux films gothiques de Mario Bava. Malgré ses faiblesses, en partie imputable aux conventions du genre, cette adaptation conserve une aura aussi fascinante que la version de Jean Cocteau.
3. La Petite Sirène de Karel Kachyna (1976).
Cette œuvre pousse la bizarrerie un cran plus loin par un procédé esthétique simple et efficace. Ne possédant pas les moyens pour un tournage en milieu sous-marin, le réalisateur a décidé de se passer d’eau. Ainsi les acteurs évoluent-ils dans une faille, illuminée par un complexe système d’éclairage bleutée. Les mouvements lents, quasi hypnotiques qu’ils doivent exécuter pour bouger sont accentués par des costumes céruléens au tissu lourd. Ce dispositif achève de poser sur l’ensemble une ambiance onirique qui sied à merveille à ce conte.
Plus proche de la version d’Andersen que de celle de l’oncle Disney, le film dégage une impression prononcée de mélancolie et de déréliction. Une curiosité à voir pour son travail sur les couleurs, ses décors et sa mise en œuvre très particulière qui – avec pas grand-chose – parvient à nous emmener dans un autre monde.
3. La Bête de Walerian Borowczyk (1975).
Longtemps victime des foudres de la censure, cette bizarrerie a été récemment rééditée sur galette numérique, depuis la rétrospective consacrée au réalisateur par le centre Pompidou. Variation érotique de La Belle et la Bête, le film s’ouvre sur une situation vaudevillesque au possible : un châtelain désargenté tente de sauvegarder son domaine en mariant son fils à une riche américaine. Pour être valable, la cérémonie doit être célébrée par un Cardinal, et dans un temps imparti. C'est donc un groupe de personnages, tous plus cupides les uns que les autres, qui se retrouvent à attendre Godot.
Sauf que cette introduction n’est qu’un prétexte élaboré pour préparer le morceau de bravoure. Car en s’ouvrant sur des gros plans de sexe de chevaux à l’occasion d’une sailli, le réalisateur nous vend assez vite la mèche. Son propos tournera autour de nos rapports contrariés avec le sexe et notre inconscient pulsionnel. Et le conte éponyme dans tout cela ? Il intervient lorsque ladite fiancée – un peu niaise – découvre une étrange légende locale et commence à fantasmer sur les exploits de son héroïne qui aura tenu en respect une fameuse « Bête »… Le film éclate en une séquence hallucinante dans laquelle une jeune châtelaine est poursuivie puis prise de force par un loup-garou priapique. Si les effets de la créature demeurent sommaires, il faut avouer que la scène reste d’une efficacité assez troublante. D’autant qu'elle dure, s'allonge excessivement, accompagnée par une sonate pour clavecin répétitive...
En effectuant des ponts par le biais du montage entre le songe et la réalité, usant d’une certaine forme de pensée magique, ce film ne cesse de s’adresser à notre inconscient – peut-être la fameuse « Bête »…
4. The Cat who wore Sunglass de Vojtech Jasny (1963)
Une petite ville de la province de Tchécoslovaquie accueil une bande de saltimbanques comportant dans leurs rangs un magicien volubile, mais surtout un certain chat portant des lunettes de soleil. Le félin possède un pouvoir : son regard révèle la nature des gens qu’ils fixent, les teintant d’une couleur symbolique. Ceux que le sortilège touche ne peuvent pas s’empêcher de danser et de se perdre dans une folle sarabande.
Fable sur le communisme, avec ses mesquins délateurs zélés qui se retrouvent soudain exposés, comédie enfantine et musicale, ce film c’est un peu de tout cela à la fois. La photographie et la mise inventive finisse par emporter l’adhésion et ce sont surtout les morceaux d'anthologie comme le spectacle de magie ou les scènes pendant lesquelles le chat révèle la « nature » de chacun qu’explose la créativité des artisans tchèques.
Si tout cela s’avère assez léger – quoique la parabole soit tout à fait applicable à notre économie capitaliste –, ce n’en est pas moins un plaisir pour les yeux, d’autant que les acteurs s’y adonnent avec un vrai entrain, en particulier les gamins qui sonnent souvent juste.
5. Valerie and her Week of Wonder de Jaromil Jires (1970)
Le jour de ses premières règles, la jeune Valérie bascule dans un monde menaçant dans lequel la guette un étrange vampire qui ressemble à son père.
Comme dans énormément films présentés dans cette rétrospective la mise en scène et le jeu des lumières flattent les yeux et l’on sent que les artisans ont l’habitude de créer des enchantements avec pas grand-chose sous la main. Il n’y a pas un photogramme qui ne soit pensé et composé avec soin. En revanche, il n’en est pas de même pour le scénario.
Décousu à l’extrême, mais surtout incroyablement malsain vis-à-vis de sa juvénile héroïne exposé de manière un peu trop équivoque, cette œuvre prête le flanc à une critique virulente. Car si l’on aurait pu avec un pareil canevas obtenir quelque chose de fantastique, les trop nombreux moments de gêne, même pas justifié par une idée narrative, plombent l’ensemble.
À la limite du fétichisme pédophile, Valérie… ne parvient pas à combler son ambigüité morale complaisante par une légitimation scénaristique, nous laissant avec un arrière-goût nauséabond dans la bouche.