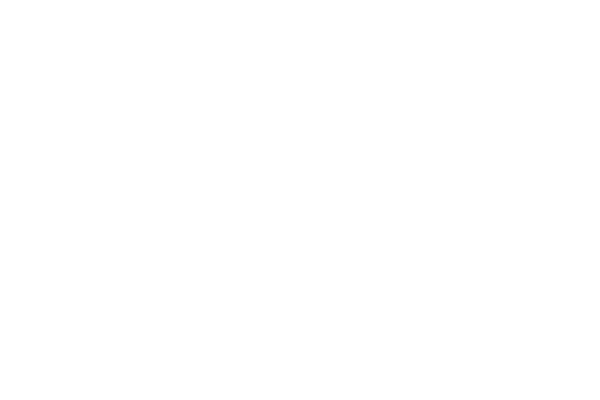Comme toutes mes tables au club ont été pulvérisées façon puzzle par madame Kauvide et ses sbires – le roi Nécron 1er et son fidèle Varan –, je n’ai plus eu l’occasion de jouer depuis quelques mois. C'est donc l'occasion de vous présenter l’œuvre du sieur Johan Scipion qui est d’une agréable fréquentation et que je vous encourage à pratiquer, si ce n'est séance tenante, au moins dès que l'on pourra, n'est-ce pas....
Sombre promet la peur « comme au cinéma »[1]. C'est-à-dire émuler d'abord les survivals des seventies, ce genre bourrin par excellence, souvent très chargé au niveau de la symbolique politique. Une caractérisation étrange, mais qui correspond très bien aux objectifs que se donne l’auteur de cette publication qui fait office d’OVNI dans le microcosme rôlistique. Ainsi les personnages-joueurs sont-ils virés de leurs podiums de héros pour devenir des putains de victimes ! Des victimes, oui, mais des victimes qui se battent et qui en chient.
Aux origines il y avait Kult, autre jeu de rôle d’horreur s’inspirant des obsessions développées par Clive Barker dans les Livres de Sang et Hellraiser[2]. Donc au programme, sexe, torture et créatures aux désirs charnels impies en mode BDSM de l’extrême. Soit la panacée pour les amateurs du genre. Hélas pour génial et impressionnant que soit cet univers, assez large pour durer des décennies, il était noyauté par un système de jeu symptomatique des années 90 : bourré de statistique dans les coins, avec une fiche de personnage lardé de détails dont, au final, on se foutait complètement étant donné l'incroyable létalité des parties. Ce qui revenait à passer des heures carrées à remplir des colonnes de chiffres, avec de « sombres secrets » et autres amorces narratives pour les mettre à la poubelle après 10 minutes. Si pour moi la création des personnages-joueurs est une porte ouverte sur un univers, une sorte de sas comme l'est un générique de film, cet aspect de Kult n’était pas le mieux pensé.
Aussi Johan Scipion a-t-il empoigné le taureau par les cornes pour débarrasser l’horreur rôlistique de sa pire tare : les règles touffues. Pas de gras ici. Une fiche minimaliste qui donne au joueur quelques traits, une phrase lapidaire en guise de caractérisation et une jauge psychique et physique qui baissera très, très vite. Grâce à cette prise en compte des attritions qu’encaissent les personnages, les parties tournent rapidement au pugilat, les infortunés protagonistes pétant les plombs dans la grande tradition d’un huis clos zombiesque à la George A. Romero.
On le voit, l’auteur a étudié son jeu lors de multiples parties et en a peaufiné tous les aspects, privilégiant la vivacité du récit aux corsets de la simulation à tout crin. L’improvisation est un moteur fécond de Sombre : à partir d’un simple canevas archétypal, car l’horreur n'a qu'un nombre de déclinaisons restreintes, il est tout à fait loisible de dériver dans plusieurs directions et ambiances. Ce qui fait la véritable beauté du genre, ce sont les innombrables torsions que l’on peut appliquer à son schéma narratif à priori anémique. Halloween de John Carpenter et Massacre à la Tronçonneuse de Tobe Hooper racontent une histoire très similaire et pourtant les deux films sont différents dans leur exécution – magistrale – et ne procure pas le même genre d’angoisse au spectateur. La seule « faiblesse » que l’on pourrait trouver à cette proposition élégante est qu’il faut un maître de jeu qui ait un peu de bouteille, qui soit apte à improviser avec éloquence. Cela demande aussi des joueurs capables de lâcher leurs Aïe-Phone pour se concentrer sur l’ambiance. Une bonne partie d’horreur, comme un film du même acabit, ça se mérite !
Dans le souci de continuer sa gamme, et pour explorer d’autres possibilités, Johan Scipion a ainsi diversifié son jeu en plusieurs sous-déclinaisons qui ont toutes leur utilité en fonction de ce que vous cherchez à faire vivre à vos joueurs. Vous voulez initier en douceur vos proches à la pratique rôlistique ? Le très minimaliste Sombre 0 est fait pour vous, avec quelques scénarios pas piqués des hannetons. Personnellement, j’ai mené plusieurs fois Deep Space Gore, Toys Scaries & Les Grimmies avec une indéniable réussite auprès de parfaits étrangers, en convention et en soirée ludique dans les bibliothèques.
Dans le souci de continuer sa gamme, et pour explorer d’autres possibilités, Johan Scipion a ainsi diversifié son jeu en plusieurs sous-déclinaisons qui ont toutes leur utilité en fonction de ce que vous cherchez à faire vivre à vos joueurs. Vous voulez initier en douceur vos proches à la pratique rôlistique ? Le très minimaliste Sombre 0 est fait pour vous, avec quelques scénarios pas piqués des hannetons. Personnellement, j’ai mené plusieurs fois Deep Space Gore, Toys Scaries & Les Grimmies avec une indéniable réussite auprès de parfaits étrangers, en convention et en soirée ludique dans les bibliothèques.
Trois scénarios aux ambiances différentes qui évoquent autant les Alien-like qui pullulaient dans les années 80 que le très bizarre et barré Dolls de Stuart Gordon, en passant par une inspiration contes de fées gore. Soit que du velours en ce qui me concerne. Les conseils de maîtrise qui remplissent les pages du magazine sont d’ailleurs excellents et il est recommandé de les potasser avant de mener la partie. Ces histoires courtes m'ont permis de multiplier les parties en un temps record, à l’inverse d’autres systèmes beaucoup plus chronophages. Alors certes, on y perd un peu en immersion – quoiqu’avec de bonnes descriptions, on peut s’en sortir –, mais l’amusement et là, et l’horreur demeure, pour le moment, un genre dont l’évocation fait toujours appel à un imaginaire collectif puissant pour sauter au-dessus des pénibles présentations d’univers. Je n’en ai tiré que des personnes qui ont apprécié l’expérience et qui n'ont, pour une grosse majorité, jamais touché un seul livre de gidéaire de leurs vies. J’ai même testé certains de ces scénarios avec des têtes blondes qui se sont assez vite prises au jeu, au point de se faire parfois de belles vacheries, m’offrant quelques parties mémorables.
Le numéro 9 se penche sur les actionner-horrifiques, dans la droite descendance d’Aliens de James Cameron ou le Vampires de John Carpenter. Une variation « Sombre Max » que je n’ai pas encore eu l’occasion de tester, mais dont je gage que je trouverai bien le moyen de le maîtriser à un moment ou à autre. Il faut dire que Johan Scipion nous présente un scénario redoutable d'efficacité qui reprend la partie centrale de la nouvelle L’Appel de Cthulhu de Lovecraft, ce qui fait plaisir à l’amateur de Lovecrafteries que je suis. L’horreur mêlée au bourrin m’a toujours paru une excellente option, d’autant plus que les armes à feu ou tranchantes font rarement dans la dentelle. Donc oui, trois fois oui ![3]
Mais un de mes fascicules préférés restent le 8 : son décor archétypal de slasher et sa cohorte d’idées de scénario en font un puits d'inspiration sans fond. Vous pourriez passer toute une année à utiliser le même décor sans en éprouver de lassitude tant les itérations proposées sont variées et amusantes. Le système minimal « 0 » appliqué à ce type de récit – difficilement transposable en jeu de rôle, du fait que les protagonistes ne sont que de la chair à boogeyman – est un coup de génie. De fait, le scénario A Man after Midnight est un exemple de rigueur et de sobriété d'écriture. 0 oblige, les personnages ont une durée de vie extrêmement limitée et les rencontres avec l’émule de Jason Voorhes sont aussi courtes que sanglantes. Cela demande bien sûr de grandes capacités d’improvisations et de descriptions de la part du MJ — en particulier sur les meurtres spectaculaires qui sont l’apanage du genre —, mais en poussant le concept à fond, avec un tirage au sort de personnages qui ne dépareilleraient pas dans le camp de vacance de Cristal Lake, on tient là une pépite ludique bien fendarde.
Mais un de mes fascicules préférés restent le 8 : son décor archétypal de slasher et sa cohorte d’idées de scénario en font un puits d'inspiration sans fond. Vous pourriez passer toute une année à utiliser le même décor sans en éprouver de lassitude tant les itérations proposées sont variées et amusantes. Le système minimal « 0 » appliqué à ce type de récit – difficilement transposable en jeu de rôle, du fait que les protagonistes ne sont que de la chair à boogeyman – est un coup de génie. De fait, le scénario A Man after Midnight est un exemple de rigueur et de sobriété d'écriture. 0 oblige, les personnages ont une durée de vie extrêmement limitée et les rencontres avec l’émule de Jason Voorhes sont aussi courtes que sanglantes. Cela demande bien sûr de grandes capacités d’improvisations et de descriptions de la part du MJ — en particulier sur les meurtres spectaculaires qui sont l’apanage du genre —, mais en poussant le concept à fond, avec un tirage au sort de personnages qui ne dépareilleraient pas dans le camp de vacance de Cristal Lake, on tient là une pépite ludique bien fendarde.
Les Hors-série qui complètent la collection apportent un lot conséquent de nouvelles techniques, de scénarios et de suggestions qui en font de toute façon une acquisition d'agrément pour vos parties, si celle-ci tourne en rond.
La plume de l’auteur est agréable, nerveuse, sèche, à l'image du cinéma qu'il cherche à émuler. Tout au plus lui reprocherais-je un emploi un peu trop fréquent d’anglicisme. Si certains critiques du milieu rôliste, dont le BHL de la discipline, champion du monde de la sodomie de drosophiles, pour reprendre la dénomination consacrée par l’auteur de Sombre lui-même, ce sont gaussés du format minimaliste du jeu, sa concision et son absence d’univers ne sont pas des défauts à mes yeux.
Car plus qu’un genre, l'horreur est surtout une ambiance, une manière de raconter des histoires. Pas d’univers ici (ou de « lore ») complexe et fouillé, mais plutôt une série de déclinaisons dans des environnements différents qui toutes reposent sur une même tonalité. Que ce soit des polars sanglants, un émule d’Alien dans l’espace ou une chasse aux cultistes dans les bayous de Louisiane, l’horreur est une épice narrative qui met l’accent sur la mortalité et le côté sale de l'existence. Une sous-culture carnavalesque et cathartique qui n’a eu de cesse de nous présenter un miroir déformant de nos pires tares et donc une saine manière de ricaner. Et c’est ça qui est bon !
Car plus qu’un genre, l'horreur est surtout une ambiance, une manière de raconter des histoires. Pas d’univers ici (ou de « lore ») complexe et fouillé, mais plutôt une série de déclinaisons dans des environnements différents qui toutes reposent sur une même tonalité. Que ce soit des polars sanglants, un émule d’Alien dans l’espace ou une chasse aux cultistes dans les bayous de Louisiane, l’horreur est une épice narrative qui met l’accent sur la mortalité et le côté sale de l'existence. Une sous-culture carnavalesque et cathartique qui n’a eu de cesse de nous présenter un miroir déformant de nos pires tares et donc une saine manière de ricaner. Et c’est ça qui est bon !
En conclusion, Sombre est une de ses pépites – avec Tranchons & Traquons – qui réinvente le loisir en le dégraissant de ses innombrables tableaux de statistiques pour aller droit à l’essentiel. Pécuniairement à la hauteur des bourses les plus maigres, ce jeu est une excellente porte d’entrée dans ce loisir particulier, que l’on soit des vieux briscards ou des nouveaux venus.
Chapeau bas, monsieur Johan Scipion.
____________________________________________________________
[1] — Ça aussi ça risque de bientôt disparaître, merci à tous ceux qui ont plébiscité les chiasses culturelles de l’Oncle Nickey qui a dorénavant un monopole encore jamais vu sur l’ensemble de la production américaine et donc mondiale. Il va être de plus en plus difficile d’échapper aux pets puritains de la compagnie aux oreilles rondes, à ses étrons numériques colorés à la diarrhée de CGI, à son idéologie hypocrite sur coulis de fumiers opportunistes et à son révisionnisme historique venu tout droit du fond de la plus profonde cuvette de chiottes repeintes par un Hitler qui se serait drogué aux laxatifs. Mais bon, vous l’avez tous voulu, hein ?
[2] — Si vous ne l’avez jamais lu, c’est l’occasion de parfaire votre culture horrifique !
[3] — Je m’excuse ici auprès des gens sensibles et des associations vertueuses qui prétendent imposer une manière de jouer et de décrire, désolé, mais une lame de sabre ça tranche, une épée ça transperce et une salve de mitraillette ça coupe un homme en deux. Autant dire que tout cela est sale, que ça pisse le sang et que ça en fout partout. Sans parler des cris d’agonies des victimes. Alors, vous pouvez en rester à vous branler l’occiput en titillant des points de vies, personnellement je préfère pratiquer le gore dans tous mes jeux de rôle, tout au moins si combat il y a. Cela ajoute un supplément de crédibilité que n'auront jamais des super-héros en caoutchouc-mousse qui traverse du béton sans une égratignure. Parce qu’un corps humain, même bien entraîné contre une surface en granit, ça fait juste un cadavre explosé, les organes étalés aux alentours, et les os surgissant d’un magma de tissus détruit. Ni plus, ni moins…