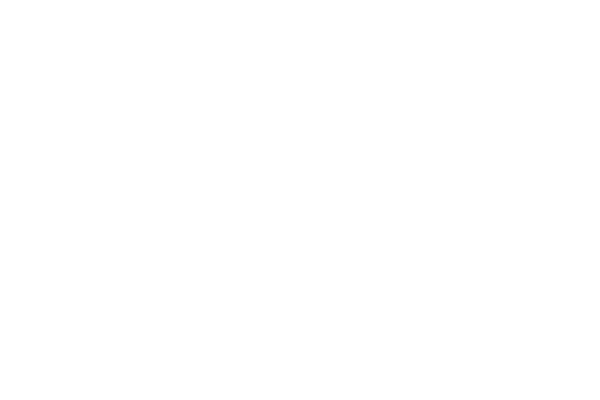Comme vous le remarquerez peut-être, le nom d'un personnage a été modifié, en raison d'une homonymie avec le nom d'une héroïne dont les aventures ont été récemment mises en image par Hollywood...
[Chapitre 16 : Ark'Yelïd]
[Chapitre 17 : Des Adieux]
[Chapitre 18 : Le Dauphin]
[Chapitre 19 : Allytah]
[Chapitre 20 : L'Arsenal]
[Chapitre 21 : Chevaux d'Acier]
[Chapitre 22 : Le Grand Réfectoire]
Le Dauphin exécuta encore une dizaine d’allers-retours pour servir tous les convives. Il reconnut du coin de l’œil quelques prêtresses d’Erzulie, un attribut divin dissimulant le fait qu’il s’agissait de vulgaires putains. Son père avait régulé de manière très stricte cette activité licencieuse, à défaut de pouvoir l’interdire. Elles reluquaient avec insistance son auguste personne. Dans un monde ordonné, elles auraient dû détourner le regard de sa présence. Elles n’étaient même pas dignes de ramasser son pot de chambre. Il frissonna sous le poids de cet espionnage malsain, mais il n’en continua pas moins de suivre les instructions qu’on lui avait données à la lettre. Lorsque toute l’assistance fut pourvue d’une assiette grasse, les responsables des cuisines quittèrent leurs casseroles pour s’attabler à leur tour.
On attendait un événement dont le Dauphin ne saisissait pas la nature. La pitance ne servait qu’à patienter, qu’à rasséréner les corps alors que l’esprit battait les chemins de l’angoisse. Le Dauphin écoutait les rumeurs qui circulaient d’un auditoire à l’autre. Lui-même n’ignorait pas que les assauts des adorateurs de Sol, que certains conseillers soupçonnaient d’attiser les dissensions entre les seigneurs, demeuraient un sujet de préoccupation dans les alcôves du palais. Son père avait eu beau jeu de tenir le royaume d’une main de fer grâce aux sigils même si n’importe quel mage débutant pouvait retourner ces gadgets contre lui. L’origine trouble des membres de la secte nihiliste et leurs indéniables pouvoirs de fascination sur toutes les couches de la population ajoutaient à la perplexité de la commanderie qui était incapable de prévoir les attaques. Les quelques prisonniers vivants qui étaient amoureusement travaillés par les tortionnaires de l’armée se laissaient mener à l’abattoir sans desceller les lèvres. Mais ce qui se passait à Mabs dépassait en amplitude tout ce qui avait eu lieu jusqu’à maintenant, car la secte était parvenue à mettre la main sur un fief entier.
Le Dauphin songea qu’il rentrait dans ses prérogatives d’avertir son père. Son éviction du palais l’avait vexé bien plus qu’il ne le pensait. Mais ses devoirs envers sa terre lui intimaient de taire ses griefs personnels, tout au moins de manière temporaire. Il n’excluait pas, ce fâcheux épisode derrière lui, d’éjecter de son trône ce vieillard qui n’en finissait pas d’agoniser. Place à un sang neuf ! Peut-être profiterait-il du chaos naissant pour enrôler quelques fidèles sous sa férule et se bâtir une faction dévouée à sa cause, prête à renverser l’hégémonie de Jehan pour son unique bénéfice ? Dès que sa voix s’éclaircirait, il commencerait ses entreprises de séduction parmi tous les gueux qu’il avait sous la main.
En attendant, il se sustentait avec difficulté, chaque bouchée lui arrachant des trépidations de douleur. Les aliments griffaient les parois de sa trachée en feu. Il perçut un mouvement sur la petite scène qui surplombait la salle. Dans un premier temps, il ne reconnut pas les deux personnes qui s’avançaient vers eux, puis ses yeux se dessillèrent. Son protecteur progressait, accompagné d’un des héros de la Prophétie. Et il comprit soudain pourquoi son père l’avait entraîné vers cette saleté d’auberge miteuse. Si on lui avait demandé quelques jours auparavant, jamais il n’aurait parié que l’un – ou l’une – des pires compagnons de quête de l’Élu filait des jours mornes dans une gargote forestière insalubre. Même après le tir ajusté dont il avait été la première victime, il aurait nié l’évidence. Jusqu’à maintenant.
Toutes les conversations cessèrent. Les regards se tournèrent vers la présence ténébreuse qui les embrassait tous. Le Dauphin éprouva un authentique frisson de terreur. Les muscles de sa gorge se rétractèrent, lui rentrant la tête dans les épaules, lui conférant une expression pincée du plus haut ridicule. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, cherchant un coin où il aurait pu se couler pour échapper à la silhouette noire qui le toisait, comme si elle lisait à travers lui, découvrant le crime dont il s’était rendu coupable.
Elle s’avança encore près du bord dans un silence surnaturel que même ses pas ne venaient pas troubler. Sa grande cape de cuir s’enroulait autour d’elle, gommant ses formes. Son visage disparaissait dans les ombres du chapeau et seul l’unique œil valide brillait d’un éclat luciférien. Un bras sortit des plis du tissu. C’était un membre d’acier beaucoup plus imposant que le premier, hérissé d’écailles. Il émanait de ses arêtes tranchantes une indéniable menace. Derrière elle, Eldridge, toujours engoncé dans son armure, paraissait presque fluet. Enfin, le timbre rauque de la Noctule sectionna le silence.
— À ce que je vois, vous êtes encore nombreux… Je vous remercie d’avoir survécu, sincèrement. Et je suis désolée que le seigneur Vanakard ait agi comme il l’a fait. Ce soir, nous pouvons lécher nos plaies, mais en atten…
Une voix s’éleva depuis le fond de la salle. Le Dauphin reconnut l’énorme cuistot qui l’avait humilié. Il ne s’étonna guère que le rustre interrompe l’héroïne de la Prophétie de façon aussi cavalière. Il n’avait aucune manière !
— C’est bien tout ça, mais vous êtes qui, par la couille droite de Bakkhuas ? Et où diable la patronne est-elle passée ?
Le Dauphin se cala dans son siège pour savourer la réaction de la tueuse. Eldridge s’avança, le regard mauvais vers l’impudent, prêt à dégainer sa lame. Allytah tendit sa main valide vers lui, l’arrêtant dans son mouvement.
— Vous avez raison de demander, et je suis désolée d’avoir dû vous duper pendant si longtemps…
Elle ôta son chapeau, révélant son mufle. Elle conservait une posture hiératique et calme face aux jugements. On chuchota à voix basse. Le Dauphin la contempla avec une attention accrue et en conclut deux choses : elle était habituée à la prise de parole en public et son maintien, sa gestuelle théâtrale et soignée lui évoquaient la noblesse. Lui aussi avait eu des précepteurs, des entraînements pour dompter son corps dans l’éventualité qu’il ait à prendre possession du trône plus tôt que prévu. Ces prérogatives royales impliquaient qu’il sache parler, mais également bouger à la perfection pour fasciner les foules. La Noctule n’était pas la première venue, mais rien dans les chansons et les légendes – toutes déformées puisque les bardes et les chroniqueurs avaient sans vergogne changé son sexe – n’indiquait ses origines. Le Dauphin se promit de lever le mystère.
— Avant de tenir l’auberge qui a été notre havre de paix à tous, cet endroit où l’on a travaillé, étudié ou mangé, j’étais Allytah Nédérata.
Une vieille Gobelin à la peau épinard constellée de taches de jade ouvrit ses larges yeux jaunes. Elle balbutiait presque.
— Vous êtes censée être… morte !
— Non ! Cette rumeur arrangeait mes affaires. Écoutez-moi, je vous prie. En m’installant ici, avec cet abri à proximité, je voulais tirer un trait sur mon passé de guerrière, mais les récents événements m’ont fait comprendre que je devais sortir de ma retraite. Je ne vais pas vous mentir, j’ai été très bien avec vous pendant de nombreuses années… Mais maintenant le seigneur Vanakard a ouvert les hostilités et il devra en répondre devant moi ! Avant ça, je souhaiterais vous proposer de m’accompagner pour mettre vos familles à l’abri, si c’est encore possible.
— À l’abri, mais où ça ?
Un des paysans du coin se redressa, se grattant la tête. Il portait un très vieux galurin qui dégoulinait sur son visage, lui conférant l’air d’un chien battu.
— Toutes ces terres appartiennent au seigneur Vanakard. Quand bien même vous parviendriez à abattre quelques hommes, il vous égorgerait, et nous avec.
— Je vous assure, Heldar d’Avon, que j’ai de quoi le tuer sans même qu’il le réalise, mais cela ne changera pas le problème. Le plus urgent est de mettre vos familles à l’abri. Le Chevalier Eldridge et moi-même allons au mont Auroch. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais vous y serez à l’abri, le temps de laisser passer le gros de la tempête.
Un couple de lagomorphes avala de travers son ragoût. Ils orientèrent leurs oreilles vers la Noctule et Eldridge.
— Le mont Auroch ? Dans les Hautes Marches ? Mais c’est à plus de vingt jours. Et encore… En prenant le sentier des pendus, c’est plus rapide, mais pour ça, il faut traverser le nid des Araknees. L’autre voie, c’est par le chemin des Éplorées dans le comté de Brune, mais le coin est réputé hanté…
Allytah claqua de la langue. Sans paraître désarçonnée par les récriminations de ses ouailles, elle continua.
— Je ne crois pas que les hommes de Vanakard soient tentés de nous poursuivre à travers le nid. Et de toute façon, sachez que la reine des Araknees est, en quelque sorte, une de mes connaissances… Nous pourrons donc traverser son territoire. De plus, les soldats auront trop peur de déclencher une guerre avec eux. Réfléchissez, pesez le pour et le contre. Je ne vous cache pas que le voyage sera périlleux et que nous n’avons qu’un ou deux jours avant que Vanakard réalise que le prévôt et les siens ne sont plus que cendres…
Un brouhaha gagna l’assemblée, chacun évaluant les pertes possibles. Personne ne se décidait. Le Dauphin observait les visages, tous crispés dans une intense réflexion. Pour sa part, il n’avait pas le choix tant qu’il était sous la tutelle d’Eldridge, mais il ne comprenait pas l’hésitation des gueux.
— Et nos familles ?
— Embarquez-les avec vous.
Allytah les embrassa du regard. Elle posa une main sur l’épaule d’Eldridge qui lui jeta un étrange coup d’œil, mélange de réprobation et de gêne.
— Je sais que vous n’êtes pas rassurés, vous tous. Et vous n’êtes pas obligés de me croire sur parole, mais le Chevalier ici présent est aussi apte que moi à vous défendre. Et si vous pensez que je mens…
Allytah rabattit d’un geste vif les pans de sa cape, dégainant un Poing de Feu de son abri de cuir. Le mouvement ne dura qu’un battement de cœur. Une détonation terrifiante résonna dans toute la pièce, écrasant l’assemblée de son vacarme. Le chapeau d’Heldar d’Avon percuté par un projectile invisible gicla de son crâne, révélant sa calvitie avancée. Le vieux paysan se figea sur son siège alors que la décharge chaude roussissait les quelques rares poils qui ornaient sa tonsure. Allytah tira encore deux fois. Le couvre-chef valsa en l’air pour atterrir sur les longs cheveux blancs d’une ancienne prostituée. L’arme tournoya sur les doigts d’Allytah qui l’escamota dans les replis de sa cape. Seule la lourde fumée bleue qui s’échappait du canon trahissait sa présence. Eldridge avait à peine cligné des yeux durant toute la démonstration.
— Sachez que j’ai une certaine expérience de la guerre. Mais encore une fois, je ne vous oblige pas à me suivre…
La prostituée qui avait reçu l’antique couvre-chef s’avança vers Allytah, tenant l’étrange offrande en équilibre sur sa tête. Elle mesurait deux pieds de plus que les personnes rassemblées dans la salle. Ses traits épais, ses canines hypertrophiées et sa pilosité abondante l’apparentaient à une ethnie fière et combative qu’elle n’avait plus eu l’occasion de croiser depuis la fin de la Grande Guerre.
— Ça faisait longtemps que les filles et moi habitions à l’auberge. Ça nous a fait mal, ce qui s’est passé ce soir. Certaines sont restées sur le carreau pour défendre ces lieux. Je sais une chose, toute guerrière que vous êtes, vous ne pourrez pas mener tout un convoi à vous toute seule. Nous, Hyksos, avons aussi été les premières victimes collatérales des Dieux Noirs, mais ça, les bardes l’ont oublié. Même notre héros Warwülf, qui vous a accompagnée, a été effacé des balades, n’est-ce pas ?
— C’est exact.
— Mais certains d’entre nous sont restés en Yelgor.
Elle se tourna vers les quelques femmes qui se serraient les unes contre les autres, indécises et encore éprouvées par les événements de la soirée.
— Les filles, il ne fait aucun doute que si les adorateurs de Sol arrivent ici, nos jours sont comptés. Voulez-vous vivre sous leur joug ou continuer à vivre comme vous l’entendez ? Comme nous l’avons toujours fait ? Librement !
Les femmes se consultèrent du regard, ignorant quelle attitude adopter. Puis, d’un même mouvement, elles dégainèrent leurs dagues ornementales qu’elles tendirent vers la Noctule.
— Nous vous accompagnerons. Nous ferons de notre mieux pour vous aider.
Allytah se gratta le crâne, soulevant le rebord de son chapeau.
— Je ne vous en demandais pas tant, mesdames…
La Hyksos monta le long des marches, rejoignant la Noctule. Elle lui ouvrit les bras en signe de fraternité.
— Mon vrai nom est Gyer de Landebury.
Les deux femmes s’accordèrent une accolade. Aussitôt, une partie de l’atmosphère délétère se dissipa. Les filles se rassemblèrent autour de Gyer et d’Allytah. Une sorte de fièvre s’empara de tout le monde. Chacun offrait ses compétences pour participer au voyage. Malgré les récriminations de leur mère adoptive, Tigrishka et Yvain proposèrent leurs talents, s’investissant dans la construction de la caravane. Même si Allytah répugnait à les voir prendre leur indépendance et à se risquer droit dans une aventure pleine de dangers, il ne lui appartenait plus de brider leurs aspirations.
Un peu de musique pour se mettre dans l'ambiance...
[Chapitre 17 : Des Adieux]
[Chapitre 18 : Le Dauphin]
[Chapitre 19 : Allytah]
[Chapitre 20 : L'Arsenal]
[Chapitre 21 : Chevaux d'Acier]
[Chapitre 22 : Le Grand Réfectoire]
Le Dauphin exécuta encore une dizaine d’allers-retours pour servir tous les convives. Il reconnut du coin de l’œil quelques prêtresses d’Erzulie, un attribut divin dissimulant le fait qu’il s’agissait de vulgaires putains. Son père avait régulé de manière très stricte cette activité licencieuse, à défaut de pouvoir l’interdire. Elles reluquaient avec insistance son auguste personne. Dans un monde ordonné, elles auraient dû détourner le regard de sa présence. Elles n’étaient même pas dignes de ramasser son pot de chambre. Il frissonna sous le poids de cet espionnage malsain, mais il n’en continua pas moins de suivre les instructions qu’on lui avait données à la lettre. Lorsque toute l’assistance fut pourvue d’une assiette grasse, les responsables des cuisines quittèrent leurs casseroles pour s’attabler à leur tour.
On attendait un événement dont le Dauphin ne saisissait pas la nature. La pitance ne servait qu’à patienter, qu’à rasséréner les corps alors que l’esprit battait les chemins de l’angoisse. Le Dauphin écoutait les rumeurs qui circulaient d’un auditoire à l’autre. Lui-même n’ignorait pas que les assauts des adorateurs de Sol, que certains conseillers soupçonnaient d’attiser les dissensions entre les seigneurs, demeuraient un sujet de préoccupation dans les alcôves du palais. Son père avait eu beau jeu de tenir le royaume d’une main de fer grâce aux sigils même si n’importe quel mage débutant pouvait retourner ces gadgets contre lui. L’origine trouble des membres de la secte nihiliste et leurs indéniables pouvoirs de fascination sur toutes les couches de la population ajoutaient à la perplexité de la commanderie qui était incapable de prévoir les attaques. Les quelques prisonniers vivants qui étaient amoureusement travaillés par les tortionnaires de l’armée se laissaient mener à l’abattoir sans desceller les lèvres. Mais ce qui se passait à Mabs dépassait en amplitude tout ce qui avait eu lieu jusqu’à maintenant, car la secte était parvenue à mettre la main sur un fief entier.
Le Dauphin songea qu’il rentrait dans ses prérogatives d’avertir son père. Son éviction du palais l’avait vexé bien plus qu’il ne le pensait. Mais ses devoirs envers sa terre lui intimaient de taire ses griefs personnels, tout au moins de manière temporaire. Il n’excluait pas, ce fâcheux épisode derrière lui, d’éjecter de son trône ce vieillard qui n’en finissait pas d’agoniser. Place à un sang neuf ! Peut-être profiterait-il du chaos naissant pour enrôler quelques fidèles sous sa férule et se bâtir une faction dévouée à sa cause, prête à renverser l’hégémonie de Jehan pour son unique bénéfice ? Dès que sa voix s’éclaircirait, il commencerait ses entreprises de séduction parmi tous les gueux qu’il avait sous la main.
En attendant, il se sustentait avec difficulté, chaque bouchée lui arrachant des trépidations de douleur. Les aliments griffaient les parois de sa trachée en feu. Il perçut un mouvement sur la petite scène qui surplombait la salle. Dans un premier temps, il ne reconnut pas les deux personnes qui s’avançaient vers eux, puis ses yeux se dessillèrent. Son protecteur progressait, accompagné d’un des héros de la Prophétie. Et il comprit soudain pourquoi son père l’avait entraîné vers cette saleté d’auberge miteuse. Si on lui avait demandé quelques jours auparavant, jamais il n’aurait parié que l’un – ou l’une – des pires compagnons de quête de l’Élu filait des jours mornes dans une gargote forestière insalubre. Même après le tir ajusté dont il avait été la première victime, il aurait nié l’évidence. Jusqu’à maintenant.
Toutes les conversations cessèrent. Les regards se tournèrent vers la présence ténébreuse qui les embrassait tous. Le Dauphin éprouva un authentique frisson de terreur. Les muscles de sa gorge se rétractèrent, lui rentrant la tête dans les épaules, lui conférant une expression pincée du plus haut ridicule. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, cherchant un coin où il aurait pu se couler pour échapper à la silhouette noire qui le toisait, comme si elle lisait à travers lui, découvrant le crime dont il s’était rendu coupable.
Elle s’avança encore près du bord dans un silence surnaturel que même ses pas ne venaient pas troubler. Sa grande cape de cuir s’enroulait autour d’elle, gommant ses formes. Son visage disparaissait dans les ombres du chapeau et seul l’unique œil valide brillait d’un éclat luciférien. Un bras sortit des plis du tissu. C’était un membre d’acier beaucoup plus imposant que le premier, hérissé d’écailles. Il émanait de ses arêtes tranchantes une indéniable menace. Derrière elle, Eldridge, toujours engoncé dans son armure, paraissait presque fluet. Enfin, le timbre rauque de la Noctule sectionna le silence.
— À ce que je vois, vous êtes encore nombreux… Je vous remercie d’avoir survécu, sincèrement. Et je suis désolée que le seigneur Vanakard ait agi comme il l’a fait. Ce soir, nous pouvons lécher nos plaies, mais en atten…
Une voix s’éleva depuis le fond de la salle. Le Dauphin reconnut l’énorme cuistot qui l’avait humilié. Il ne s’étonna guère que le rustre interrompe l’héroïne de la Prophétie de façon aussi cavalière. Il n’avait aucune manière !
— C’est bien tout ça, mais vous êtes qui, par la couille droite de Bakkhuas ? Et où diable la patronne est-elle passée ?
Le Dauphin se cala dans son siège pour savourer la réaction de la tueuse. Eldridge s’avança, le regard mauvais vers l’impudent, prêt à dégainer sa lame. Allytah tendit sa main valide vers lui, l’arrêtant dans son mouvement.
— Vous avez raison de demander, et je suis désolée d’avoir dû vous duper pendant si longtemps…
Elle ôta son chapeau, révélant son mufle. Elle conservait une posture hiératique et calme face aux jugements. On chuchota à voix basse. Le Dauphin la contempla avec une attention accrue et en conclut deux choses : elle était habituée à la prise de parole en public et son maintien, sa gestuelle théâtrale et soignée lui évoquaient la noblesse. Lui aussi avait eu des précepteurs, des entraînements pour dompter son corps dans l’éventualité qu’il ait à prendre possession du trône plus tôt que prévu. Ces prérogatives royales impliquaient qu’il sache parler, mais également bouger à la perfection pour fasciner les foules. La Noctule n’était pas la première venue, mais rien dans les chansons et les légendes – toutes déformées puisque les bardes et les chroniqueurs avaient sans vergogne changé son sexe – n’indiquait ses origines. Le Dauphin se promit de lever le mystère.
— Avant de tenir l’auberge qui a été notre havre de paix à tous, cet endroit où l’on a travaillé, étudié ou mangé, j’étais Allytah Nédérata.
Une vieille Gobelin à la peau épinard constellée de taches de jade ouvrit ses larges yeux jaunes. Elle balbutiait presque.
— Vous êtes censée être… morte !
— Non ! Cette rumeur arrangeait mes affaires. Écoutez-moi, je vous prie. En m’installant ici, avec cet abri à proximité, je voulais tirer un trait sur mon passé de guerrière, mais les récents événements m’ont fait comprendre que je devais sortir de ma retraite. Je ne vais pas vous mentir, j’ai été très bien avec vous pendant de nombreuses années… Mais maintenant le seigneur Vanakard a ouvert les hostilités et il devra en répondre devant moi ! Avant ça, je souhaiterais vous proposer de m’accompagner pour mettre vos familles à l’abri, si c’est encore possible.
— À l’abri, mais où ça ?
Un des paysans du coin se redressa, se grattant la tête. Il portait un très vieux galurin qui dégoulinait sur son visage, lui conférant l’air d’un chien battu.
— Toutes ces terres appartiennent au seigneur Vanakard. Quand bien même vous parviendriez à abattre quelques hommes, il vous égorgerait, et nous avec.
— Je vous assure, Heldar d’Avon, que j’ai de quoi le tuer sans même qu’il le réalise, mais cela ne changera pas le problème. Le plus urgent est de mettre vos familles à l’abri. Le Chevalier Eldridge et moi-même allons au mont Auroch. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais vous y serez à l’abri, le temps de laisser passer le gros de la tempête.
Un couple de lagomorphes avala de travers son ragoût. Ils orientèrent leurs oreilles vers la Noctule et Eldridge.
— Le mont Auroch ? Dans les Hautes Marches ? Mais c’est à plus de vingt jours. Et encore… En prenant le sentier des pendus, c’est plus rapide, mais pour ça, il faut traverser le nid des Araknees. L’autre voie, c’est par le chemin des Éplorées dans le comté de Brune, mais le coin est réputé hanté…
Allytah claqua de la langue. Sans paraître désarçonnée par les récriminations de ses ouailles, elle continua.
— Je ne crois pas que les hommes de Vanakard soient tentés de nous poursuivre à travers le nid. Et de toute façon, sachez que la reine des Araknees est, en quelque sorte, une de mes connaissances… Nous pourrons donc traverser son territoire. De plus, les soldats auront trop peur de déclencher une guerre avec eux. Réfléchissez, pesez le pour et le contre. Je ne vous cache pas que le voyage sera périlleux et que nous n’avons qu’un ou deux jours avant que Vanakard réalise que le prévôt et les siens ne sont plus que cendres…
Un brouhaha gagna l’assemblée, chacun évaluant les pertes possibles. Personne ne se décidait. Le Dauphin observait les visages, tous crispés dans une intense réflexion. Pour sa part, il n’avait pas le choix tant qu’il était sous la tutelle d’Eldridge, mais il ne comprenait pas l’hésitation des gueux.
— Et nos familles ?
— Embarquez-les avec vous.
Allytah les embrassa du regard. Elle posa une main sur l’épaule d’Eldridge qui lui jeta un étrange coup d’œil, mélange de réprobation et de gêne.
— Je sais que vous n’êtes pas rassurés, vous tous. Et vous n’êtes pas obligés de me croire sur parole, mais le Chevalier ici présent est aussi apte que moi à vous défendre. Et si vous pensez que je mens…
Allytah rabattit d’un geste vif les pans de sa cape, dégainant un Poing de Feu de son abri de cuir. Le mouvement ne dura qu’un battement de cœur. Une détonation terrifiante résonna dans toute la pièce, écrasant l’assemblée de son vacarme. Le chapeau d’Heldar d’Avon percuté par un projectile invisible gicla de son crâne, révélant sa calvitie avancée. Le vieux paysan se figea sur son siège alors que la décharge chaude roussissait les quelques rares poils qui ornaient sa tonsure. Allytah tira encore deux fois. Le couvre-chef valsa en l’air pour atterrir sur les longs cheveux blancs d’une ancienne prostituée. L’arme tournoya sur les doigts d’Allytah qui l’escamota dans les replis de sa cape. Seule la lourde fumée bleue qui s’échappait du canon trahissait sa présence. Eldridge avait à peine cligné des yeux durant toute la démonstration.
— Sachez que j’ai une certaine expérience de la guerre. Mais encore une fois, je ne vous oblige pas à me suivre…
La prostituée qui avait reçu l’antique couvre-chef s’avança vers Allytah, tenant l’étrange offrande en équilibre sur sa tête. Elle mesurait deux pieds de plus que les personnes rassemblées dans la salle. Ses traits épais, ses canines hypertrophiées et sa pilosité abondante l’apparentaient à une ethnie fière et combative qu’elle n’avait plus eu l’occasion de croiser depuis la fin de la Grande Guerre.
— Ça faisait longtemps que les filles et moi habitions à l’auberge. Ça nous a fait mal, ce qui s’est passé ce soir. Certaines sont restées sur le carreau pour défendre ces lieux. Je sais une chose, toute guerrière que vous êtes, vous ne pourrez pas mener tout un convoi à vous toute seule. Nous, Hyksos, avons aussi été les premières victimes collatérales des Dieux Noirs, mais ça, les bardes l’ont oublié. Même notre héros Warwülf, qui vous a accompagnée, a été effacé des balades, n’est-ce pas ?
— C’est exact.
— Mais certains d’entre nous sont restés en Yelgor.
Elle se tourna vers les quelques femmes qui se serraient les unes contre les autres, indécises et encore éprouvées par les événements de la soirée.
— Les filles, il ne fait aucun doute que si les adorateurs de Sol arrivent ici, nos jours sont comptés. Voulez-vous vivre sous leur joug ou continuer à vivre comme vous l’entendez ? Comme nous l’avons toujours fait ? Librement !
Les femmes se consultèrent du regard, ignorant quelle attitude adopter. Puis, d’un même mouvement, elles dégainèrent leurs dagues ornementales qu’elles tendirent vers la Noctule.
— Nous vous accompagnerons. Nous ferons de notre mieux pour vous aider.
Allytah se gratta le crâne, soulevant le rebord de son chapeau.
— Je ne vous en demandais pas tant, mesdames…
La Hyksos monta le long des marches, rejoignant la Noctule. Elle lui ouvrit les bras en signe de fraternité.
— Mon vrai nom est Gyer de Landebury.
Les deux femmes s’accordèrent une accolade. Aussitôt, une partie de l’atmosphère délétère se dissipa. Les filles se rassemblèrent autour de Gyer et d’Allytah. Une sorte de fièvre s’empara de tout le monde. Chacun offrait ses compétences pour participer au voyage. Malgré les récriminations de leur mère adoptive, Tigrishka et Yvain proposèrent leurs talents, s’investissant dans la construction de la caravane. Même si Allytah répugnait à les voir prendre leur indépendance et à se risquer droit dans une aventure pleine de dangers, il ne lui appartenait plus de brider leurs aspirations.
_____________________________________
Un peu de musique pour se mettre dans l'ambiance...