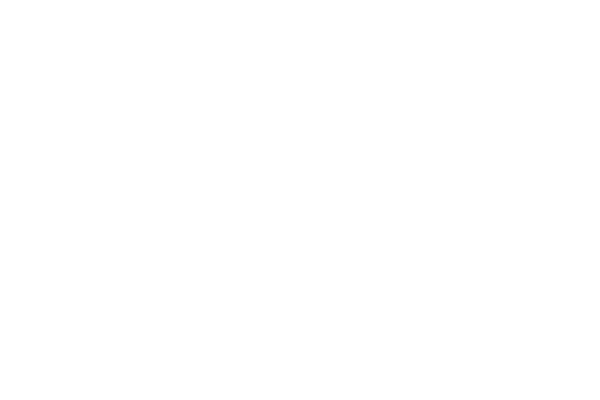Par facilité – et pour éviter les jeux de mots laids involontaires –, je vais dénommer le film et sa créature éponymes avec leurs appellations anglaises… Je dévoile quelques éléments de l’intrigue, néanmoins si vous connaissez le roman de Stephen King, cela ne vous gâchera pas la vision du film. Je signalerais enfin pour dissiper tout malentendu que je ne me focaliserais pas sur le téléfilm des années 90, celui-ci étant un gentil navet – pour être poli – qui adapte de manière appliquée et académique le roman sans jamais parvenir à en comprendre l'essence.
1.Les racines du Mal.
Ce n’est pas encore la confirmation d’un mouvement, mais il m’est forcé de reconnaître que depuis ce début d’année, le système des studios hollywoodiens a l’air d’émerger de sa léthargie créative pour nous offrir du divertissement intelligent. Ce semi-éveil – parce que pour le moment nous n’avons tout de même que deux œuvres au compteur même s’il est permis d’espérer que le Mother de Darren Aronovsky hausse le niveau d’un autre cran – semble dû à Deadpool (Tim Miller, 2016)... Même si je l’ai bien conspué pour son humour potache confondant transgression et subversion, ce film a contribué à changer la donne.
À ce protozoaire puéril a succédé un Logan (James Mangold, 2017) poussant la négation de la logique super-héroïque jusqu’au bout en suivant le chemin de croix de son protagoniste, le tout sur fond de satire politique, d’anticipation glaçante et de western crépusculaire tendance Papy Peckinpah. La longueur autant que la brutalité frontale de ce film auraient pu rebuter moult spectateurs. Pourtant, le bousin ne s’est pas gaufré au box-office. Même si j’imagine – dans mes délires – la déconfiture de certain exécutive et autre empêcheur de créer en rond face à cette « découverte » : il y a un public prêt à donner du bon pognon pour mater des films avec un contenu mature [1]. Cyniques et âpres au gain, les studios lâchent un peu la bride aux créateurs pour les laisser mener leurs barques tant que celle-ci demeure source d'immenses profits, quitte à mettre en boîte des scènes naguère impensables dans le cadre des fictions destinées à une distribution en multiplexes. Une petite giclée d’air frais dans une production vérolée par la néoténie mentale.
Fin 2017 la sortie de IT, nouvelle adaptation du pavé éponyme du Roi de l’Horreur, déboule en Europe, marquée dans son carton d'exploitation d'un franc « rated R ».
 |
| Je suis nostalgique des couvertures baveuses de Matthieu Blanchin. Effet garantis sur les petits vieux et les bigots dans les transports en commun... |
2. L’Antre de l’Innommable.
Le foisonnant roman de Stephen King prend ses racines à la source même des contes de fées. En lisant IT, il est impossible de ne pas songer autant à ses villages obscurs de légende donnant en sacrifices des vierges au dragon,qu'aux nouvelles de H.P.Lovecraft [2] et à ses bleds paumés malsains. Narré en entrecroisant plusieurs lignes temporelles et plusieurs témoignages qui se recoupent sans cesse – King se pose en héritier direct de la méthode Lovecraftienne –, le récit suit les aventures des gamins qui s’opposeront à IT mais aussi aux traces que laisse celui-ci sur les citoyens de Derry. Car, sans même qu’il ne soit nommé, un pacte lie la ville et le monstre. Un contrat funeste qui aveugle les adultes aux tourbillons de violence et aux disparitions disproportionnées d’enfants dont se sustente goulument IT. Une cécité volontaire qui s’explique par la nature particulière de l’antagoniste.
Le Clown maléfique — un des nombreux avatars de cette chose protéiforme — est autant une créature venue d’ailleurs, qu’un égrégore né des débris de la psyché collective d’une bourgade en voie de déliquescence économique. C’est discret, mais présent dans le roman, grâce à la présence de friches industrielles servant de manière récurrentes de décors, de même que les références à un « bon vieux temps ». Une époque sereine qui n'existe que dans la tête des habitants si l’on en juge par les événements sanguinolents qui ont parsemé l'histoire de Derry. Tous plus atroces les uns que les autres, ces pogroms et massacres haineux – renvoyant à la crème du pire des États-Unis – s’avéreront bien plus effrayants que les apparitions du monstre.
En revanche, les attaques de IT permettent à King de s’en donner à cœur joie dans le style outré hérité des comics Tale from the Crypt, faisant souvent preuve d’un humour cynique guignolesque. Cet excès est somme toute logique puisqu'il s'agit pour le IT de matérialiser des peurs enfantines. Le Clown est d’ailleurs évincé à de nombreuses reprises de sa place d'ogre ultime par ses agents, de « simples » humains comme le père de Beverly Marsh ou Henri Bowers, un adolescent violent dont la folie atteindra des sommets dans le dernier tiers du roman, le transformant en une terreur bien plus tangible que les spectres rigolards de Pennywise…
En résulte un pavé qui navigue en permanence entre l’enfance et le temps de l’adulte, conférant une vaste amplitude à cette hantise, mais aussi une énorme difficulté d’adaptation pour donner corps à l’écran aux impressions des personnages et à l’étendue quasi cosmique de l’horreur qui possède la petite ville à travers les siècles. Il faut élaguer dans un texte aux ramifications multiples de manière judicieuse, quitte à trahir le style pour conserver l’essence du sujet… Un travail d’écriture ardu, que les scénaristes – au nombre desquels Cary Fukanaga [3] – auront accompli avec brio.
 |
| Un goût du grotesque prononcé issu directement des pages de Tales from the Crypt. |
2. Le Club des Ratés.
Les auteurs ont tranché dans les pages pour rentrer tout cela dans un film qui atteint les 2h15 – une durée énorme pour un film d’horreur – en essayant de conserver les spécificités des protagonistes principaux tout comme celle de la ville de Derry, immense vivier d’effrayants psychopathes.
La première bonne idée est donc d’avoir sabré dans la structure en boîtes gigognes de l’œuvre de King pour ne conserver qu’une seule époque et de dépoussiérer celle-ci, faisant passer la formation du « Club de Ratés » des années 50 aux années 80 [4]. Une décennie qui, si elle est en grande partie fantasmée dans la pop-culture contemporaine, n’est ici qu’un contexte autour duquel tournera la narration. On est très loin du catalogue complaisant de la série Stangers Things (Matt & Ross Duffer, 2016) qui – même si elle joue dans une catégorie similaire – en fait tellement des caisses pour donner des coups de coude dans les côtes du spectateur que cela en devient gênant. Cette division en deux films distincts offre aussi l’avantage de proposer une histoire complète avec un début et une fin, si jamais le premier chapitre devait se vautrer au box-office.
L’action commence par l’assassinat du jeune Georges Denbrough. Un meurtre fondateur qui poussera à son frère Bill « le Bègue » dans une quête de revanche. Une première attaque qui donne le ton : les auteurs ne vont pas nous épargner. Outre la présence continuelle de l’eau comme élément menaçant – IT est une créature aquatique – surgit déjà en moins de dix minutes l’idée que les braves citoyens n’en ont strictement rien à foutre qu’un gosse se fasse arracher un membre en pleine rue. Si le téléfilm coupait au moment où le Clown attrapait le bras de Georges, sa nouvelle itération nous montre la scène de manière frontale. Comme à la bonne vieille époque du gore, ce procédé nous signifie que si un protagoniste doit expirer dans d’atroces souffrances, il mourra ! Une note d’intention pour le moins violente qui aura le double mérite de nous scotcher au fauteuil et de nous garder attentif pour la suite des événements, puisque les règles de bienséances hollywoodiennes ne sont plus… [5].
Passé ce cap du choc initial, le film pose développe sa narration avec patience, distillant les séquences d'épouvante virtuoses avec parcimonie. Se focalisant sur Bill — par souci d’efficacité dramaturgique —, les auteurs n’en oublient pas moins les autres membres du Club des Ratés, chacun ayant droit à son apparition et à ses antagonistes personnels, incarnés par des adultes. Là aussi des choix ont été faits et tous les protagonistes n’ont pas une histoire aussi aboutie que le trio formé par Ben Hanscom, Beverly Marsh et Bill Denbrough. Néanmoins les efforts d’écritures effectués rendent la dynamique de groupe crédible et font très souvent mouche.
Les scénaristes évacuent une partie des informations du roman, mais ils conservent l'essentiel, pour mieux nous plonger dans l'ambiance délétère de Derry. C’est le rat de bibliothèque Ben Hanscom, – un lieu qui a toujours eu une certaine importance dans les fictions de S. King – qui fournira les principaux événements douteux du passé de Derry, marquée par les sacrifices rituels dédiés à IT. Une manière raffinée de compenser une énorme difficulté de l’adaptation – la présence des apartés historiques – sans pour autant faire l’impasse sur ceux-ci puisqu’ils sont capitaux pour comprendre le fonctionnement de cette entité et son action sur son cheptel humain.
3. Ogre Intime.
La mise en scène élégante d’Andy Muschetti se positionne à la hauteur de ses héros, parvenant à transmettre par le biais de cadrages expressionnistes de Chung Chung-Hoon, un sentiment d'oppression et de paranoïa palpable. Le réalisateur et son directeur de la photographie se perdent dans des décadrages incroyables, mais aussi des perspectives forcées et autres astuces visuelles pour déformer l’espace permettant de faire passer les adultes pour des géants et les maisons pour des labyrinthes angoissants. [6] En se focalisant sur toute la grammaire du film d’horreur, Andy Muschetti crée des séquences viscérales avec une économie de moyen salutaire en cette période de débauche numérique tous azimuts.
La mère hypocondriaque d’Eddie Kasprack est filmée comme un titan, une caricature grotesque de la marâtre étouffant sa progéniture sous sa maternité malsaine. Et que dire du Père de Beverly Marsh dont les rares, mais funestes apparitions créé une gêne palpable ? Le moment où celui-ci tient la main de sa fille restera comme un de ces instants d’anthologie de cinéma concentré dans un plan d’une simplicité confondante. C’est dans cette manipulation constante entre le grotesque enfantin – les séquences du Clown – et l’horreur intrafamiliale que le film s’avérera le plus fin pour malmener nos nerfs. Des adultes, tous présentés comme des dépravés et des tarés congénitaux, dont il n’y aura aucun salut à attendre. Si IT vous massacre au coin de la rue, pas un ne lèvera le doigt. Pire encore, certains d'entre eux sont téléguidés par la créature... ou peut-être leur « Ça »…
La transposition dans les années 80 — outre le fait d’actualiser les référents culturelles du roman qui dataient des années 50 et ne parlaient plus forcément aux générations actuelles — permet aux auteurs de mieux rendre prégnante l’influence et l'omniprésence morbide de IT, via une émission de télé glauquissime où raisonne ses injonctions devant des spectateurs scotchées passivement devant l'écran. Une discrète critique des médias comme abrutissement de masse ? En tout cas un expédient très utile pour matérialiser l’emprise psychique du monstre sur les habitants de la ville.
La durée limitée du film a obligé les scénaristes a taillé dans le gras du roman, les apparitions terrifiantes d’Henri Bowers sont condensées au strict minimum, et les colères du père Marsh baissent d’un cran dans l’odieux. Si la dernière scène opposant Beverly à son paternel eût été insupportable transcrite tel quel à l'écran, IT nous met sous le nez une collection de ce que l'humanité a fait de pire — et hélas de très réel — en terme de parentalité dysfonctionnelle sans pour autant tendre vers le misérabilisme complaisant. IT de l’horreur social ? Pourquoi pas ! Ce sujet apparaît après tout en creux dans le livre et poursuivra les personnages longtemps après les événements.
Car IT c’est aussi en psychanalyse cette partie reptilienne, incontrôlable, de l’esprit qui veut tout et tout de suite et qui ne connaît pas les barrières de la civilisation. Une entité pulsionnelle que les états seconds – comme l’alcoolisme – sortent bien souvent de sa cage. IT est-elle vraiment une chose venue des espaces glacés ou un produit de la psyché collective de cette petite ville du Maine dans les foyers de laquelle chacun s’adonne au martyr de la chair de sa chair ? Un thème pour le moins redoutable sur lequel les auteurs ne donnent aucune réponse, mais qu’ils effleurent néanmoins avec une justesse… Qui fait peur !
4. De l’humour, de la magie et de la cruauté enfantine.
Les horreurs qu’auront à affronter les membres du club des ratés ne doivent pourtant pas faire oublier que le ton du film, à l’image du roman, s’offre très souvent des ruptures de ton. Ainsi IT manifeste un humour cynique lorsqu’il joue avec ses proies comme en témoigne le choix des trois portes : « un peu effrayante », « effrayante » ou « très effrayante » qui renvoie aux facéties mortelles d’un certain Freddy Krueger.
C’est dans cet équilibre, ce balancement constant entre les différentes teintes émotionnelles que le film se révèle le plus astucieux. Si la comédie est le pendant coloré de l’horreur, alors les auteurs ont réussi à danser sur le fil d’un rasoir sans verser dans l’excès pour ne pas rendre l’horreur ridicule et l’humour sinistre. Ils sont aidés par un montage au cordeau, des acteurs impliqués et un sens du rythme redoutable. Les gestes sonnent toujours très juste et les phases comiques parviennent même à s’insinuer dans les séquences d'épouvantes, car celles-ci, focalisées sur une vision enfantine usent sans retenues de design poussant assez loin les curseurs du grand-guignol comme le lépreux qui poursuit Eddie Kasprack qui n'aurait pas dépareillé dans une planche de BD de Jack Kamen.
Le second intérêt de cette adaptation est qu’elle conserve – bien que de manières plus ténue et suggestive – les considérations du romancier sur la magie en utilisant à rebours des clichés longtemps moqués du film d’horreur. Ainsi, nos héros ne peuvent vaincre IT que lorsqu’ils sont unis, aussi celui-ci va-t-il mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour les séparer. C’est le fameux stéréotype du personnage qui s’éloigne pour se perdre dans les ténèbres et se faire occire comme un agneau qu’on mène à l’abattoir. À la différence qu’ici ses réactions possèdent une explication logique, IT se servant de ses maléfices pour fasciner ses victimes.
Cette osmose magique [7] qui unit les ratés sera opérante que lorsque ceux-ci atteindront le nombre symbolique de sept membres. Si l’individu est impuissant face à la peur irrationnelle qu'incarne IT, le groupe détient un pouvoir qui contrebalance les charmes de la créature. Cette importance accordée à l’entraide régnant dans la petite communauté est magnifiée par la séquence de nettoyage de la salle de bain de Beverly, pollué par le sang de IT. Une épiphanie qui scelle un pacte au-delà des mots et qui confère aux gestes la valeur d’un exorcisme de la terreur en retournant l’arme de l’ennemi – l’eau – contre lui. Un film qui met au centre de son message la collaboration plutôt que l’individualisme forcené et le mythe de l'homme providentiel, avouez qu’on a déjà vu pire…
Enfin, notons aussi qu’à plusieurs reprises les auteurs montrent sans fards la cruauté sans limites des enfants dans toute sa brutalité. À un tel point que les scénaristes parviennent à faire basculer notre empathie lors du climax, tant l’on devine la panique de la créature clownesque, incapable soudain de se défendre contre l’assaut conjugué des membres du club des ratés. Une exécution pénible qui renvoie à celle du L’Échine du Diable (Guillermo Del Toro, 2001) ou à celle plus récente de l’homme de main du mercenaire en chef dans Logan.
En conclusion, IT a raflé la place de premier de la classe à tous ses concurrents lors de son premier week-end d’exploitation aux USA. Une véritable surprise pour un métrage pourtant pas si évident que cela : la violence frontale (sur enfant qui plus est…), les thèmes assez difficiles qu’il aborde n’assuraient pas son succès. Même si le trailer viral aura secoué la toile, il n’était pas gagné d'avance que le film emporte l'adhésion, nonobstant la marque « Stephen King » dont l’aura a quand même baissé ces dernières décennies. Peut-être est-ce parce qu’il bénéficie du revival des années 80, mais je préfère croire que l'engouement des foules possède de plus nobles causes…
Les auteurs ont conçu une œuvre sincère et ont parlé aux spectateurs comme à des personnes matures, et non comme à des demeurés, ce qui aura été récompensé. Ce tour de force narratif [8] démontre que l’on peut en 2017 continuer à fabriquer des films aussi divertissants qu’intelligents sans qu’il ait besoin de 3D et autre gadget outrancier qui – sauf rare exception [9] – n'ont jamais métamorphosé la merde en or.
Parce qu'IT revient à la base du cinématographe – une des scènes me paraît citer Méliès par son emploi d'un décor théâtral – et parvient autant à faire frissonner avec les ombres et le hors-champs, avant de lâcher du lest sur les effets numériques, enfin utilisés au service de l'histoire.
En gros, si vous ne faites rien les prochains jours, vous avez rendez-vous avec la partie la plus sombre de votre inconscient. Le voyage va être chaotique, mais cela en vaudra la peine…
__________________________________________________________
[1] — Attention, je n’ai pas dit ici un contenu « adulte », ce sont pour moi deux notions assez différentes. Des œuvres pour enfants peuvent fort bien être matures. Citons en exemple qui parlera à tous les travaux de Hayao Miyazaki qui n’ont jamais été mièvres et dont la profondeur continuera de parler aux personnes de 7 à 77 ans…
[2] — Je ne peux m’empêcher de penser que le nom de famille de Beverly, Marsh est un clin d’œil au reclus de Providence... En effet sa célèbre nouvelle Le Cauchemar d’Innsmouth met en scène une famille maudite ayant introduit un culte impie dans la petite ville portuaire, les Marsh…
[3] — Même si sa fabrication n’est pas allée sans crises comme le prouve le départ de Fukanaga (réalisateur de l’excellente série True Detective (Nic Pizzolatto, 2017)) du poste de réalisateur.
[4] — Un reproche fait au film et qui sera, à mon avis, récurrent est sa parenté avec Strangers Things dont on retrouve un des acteurs au casting. Cependant, IT a été mis en chantier avant que la série ne soit disponible sur Netflix, de plus le réalisateur n’a pris connaissance de celle-ci qu’après le tournage… Il s’agit là d’une coïncidence dû au revival des années 80 qui semble s’emparer de tous les supports…
[5] — J’ai déjà dit un mot au sujet de la violence sur ou pratiqué par les enfants, gageons qui si la levée de cet interdit est pour le moins surprenante dans les productions américaines récentes, mais il ne faudrait pas non plus que cela se transforme en habitude un peu gratuite.
[6] — Dont un super travelling contrarié que n’aurait pas renié le Tobe Hooper de Poltergeist…
[7] — Malgré toute sa bonne volonté, il aurait été impossible à Andy Muschetti et aux scénaristes d’intégrer l’une des scènes les plus osés du roman. Même si celle-ci se justifie parfaitement dans la narration et les thématiques déployées par S. King, son adaptation au grand écran aurait aussitôt entraîné un tollé monstrueux, surtout dans le contexte puritain actuel.
[8] — Stephen King emploie toutes les ressources de la littérature, toutes ses ruses et ses détours pour parvenir à ses fins. Le transcrire dans un média visuel constitue donc une authentique gageure.
[9] — A ce jour, le seul film utilisant avec intelligence et à propos la 3D demeure le Gravity (Alfonso Cuaron, 2013) que je ne remercierais jamais assez pour avoir filé une gerbe mémorable à un groupe de spectateurs confondant manifestement salle de cinéma et restaurants.